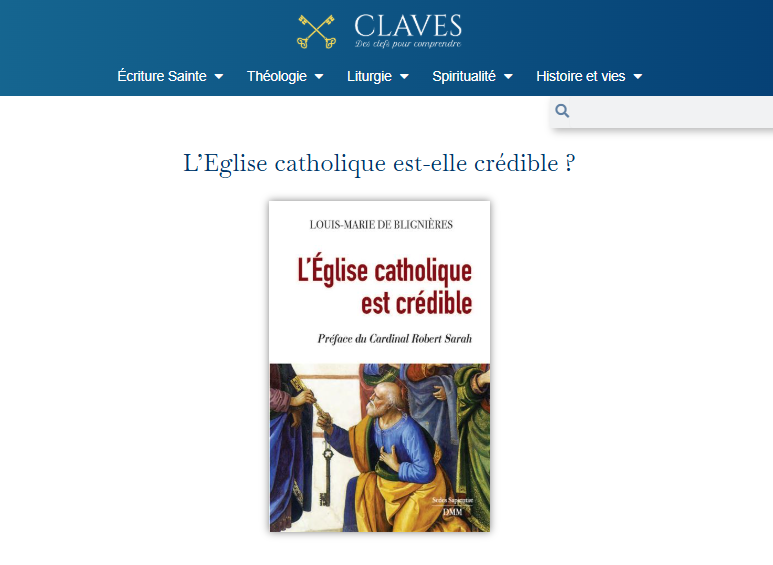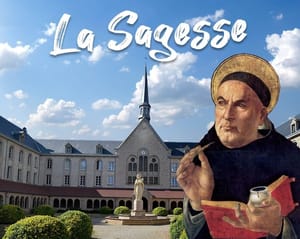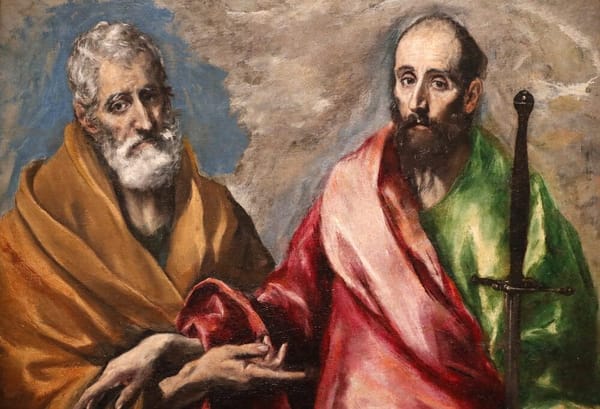Paru il y a un peu plus d’un an, l’ouvrage du RP. de Blignières posait une question aujourd’hui presque provocante : L’Église catholique est-elle crédible ? La réponse du titre est affirmative, sans ambages, fondée dans l’Écriture, la tradition et la réflexion théologique. Le RP. Laurent-Marie Pocquet du Haut-Jussé nous fait l’amitié de cette recension de cet excellent livre.
L’ouvrage du P. de Blignières, fondateur de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, manifeste une belle audace à un moment où l’Église catholique, comme institution et comme réalité de grâce, doit affronter une crise sans précédent, mais il montre aussi combien dans ces moments agités, le recours à l’intelligence et à l’histoire est plus que jamais indispensable pour d’une part conforter la foi des croyants et d’autre part interpeller tout homme de bonne volonté sur l’originalité que représente au sein de nos communautés humaines l’existence de cette réalité tout à fait originale voire unique, une société qui prétend enseigner avec autorité et communiquer le salut…
L’ouvrage se compose de sept chapitres et deux parties (I. La preuve fondamentale. II. Les confirmations), le tout constituant une catéchèse fondamentale, un parcours à la fois doctrinal et historique, une apologétique, c’est-à-dire une défense raisonnable du mystère de l’Église.
Preuve fondamentale de la crédibilité de l’Église
Le premier chapitre décrit le double aspect de la communauté chrétienne, à la fois dans sa réalité eschatologique (le Royaume de Dieu) et dans sa dimension concrète, visible et repérable dans le temps et dans l’espace. Elle est donc en continuité dynamique avec le mystère même de l’incarnation, l’infini qui se rend visible, palpable, « rencontrable ». Si beaucoup reconnaissent l’originalité et la spécificité de la première communauté chrétienne, formée autour du message et de la personne du Christ au début de notre ère, la difficulté est bien d’affirmer la continuité entre celle-ci et le peuple chrétien aujourd’hui. C’est ce à quoi s’attache le chapitre 2 : « L’unité de ces hommes [qui constituent l’Eglise tout au long des vingt siècles d’histoire qui nous séparent de la fondation historique] est formellement réalisée par l’unité de foi et la participation aux sacrements, leur finalité commune est la sanctification dans cette vie et le salut éternel, pour la gloire de Dieu et celle du Christ, qui est le point de référence de ce groupe » (p. 47). Ce peuple dès l’origine est structuré par le ministère apostolique et la primauté de l’apôtre Pierre, qualité qui est transmise à ses successeurs, sous la forme d’une primauté juridique (cf. chapitre 3). Le primat de juridiction tel qu’il a été défini par le Concile Vatican I (1870) constitue bien le résultat d’un développement dogmatique homogène, en continuité dynamique avec le donné scripturaire. L’auteur parle à juste titre, d’ « un indice d’un état institutionnel accepté » (p. 58) dès l’origine, c’est-à-dire dès l’énumération par les évangélistes de la liste des Apôtres, la primauté pétrinienne correspond non seulement à une nécessité historique mais aussi logique (cf. textes cités pp. 69-71). Le chapitre 4 explicite la continuité entre l’Eglise des origines et l’Eglise romaine, comme le reconnait d’ailleurs le grand historien protestant libéral Adolf von Harnack, même si par ailleurs il en conteste l’origine divine ou voulue par Dieu : « il est possible d’établir avec d’impressionnantes preuves que la conception catholique de l’Église naissante est historiquement la vraie, c’est à dire que christianisme, catholicisme et romanisme forment une identité historique parfaite » (cité p. 74). On trouvera peut-être un peu anachronique la question que se pose l’auteur quant à savoir si l’apôtre Pierre s’est réservé l’administration de l’Eglise locale de Rome (cf. p. 97). En revanche il se montre sensible à la difficulté et à l’obstacle que représente pour la crédibilité de l’Eglise et l’accueil de son message, le péché des chrétiens. Il mentionne avec réalisme « le cri assourdissant du mal [qui] empêche la voix du bien d’être entendue » (p. 103). Cependant l’existence de ce péché qui doit être dénoncé, hier comme aujourd’hui, ne doit pas conduite les catholiques à une attitude destructrice d’autoaccusation perpétuelle et mortifère, attitude dénoncée en son temps par le Cardinal Joseph Ratzinger (cf. pp. 104-105).
Les confirmations de cette crédibilité
Cette réflexion d’une brulante actualité permet de faire la transition avec la deuxième partie qui s’attache à montrer la pertinence du propos du Concile Vatican I, affirmant la crédibilité de l’Eglise à partir de sa propagation, de sa sainteté et de son unité (cf. p. 106). Chacune de ces confirmations fait donc l’objet d’un chapitre. Pour ce qui est de la propagation historique de l’Église (chapitre 5), l’auteur montre que celle-ci s’est réalisée effectivement malgré les contradictions, les persécutions et les calomnies dont les chrétiens ont fait l’objet dès le début de la prédication apostolique, s’adaptant aux différentes cultures, mentalités et civilisations, tout en maintenant ferment les exigences doctrinales et morales qui découle de son irréductible originalité (cf. cf. pp. 120-124).Le chapitre 6 établit la sainteté de l’Eglise : sainteté parce qu’elle communique aux hommes les moyens de se sanctifier et parce qu’on peut constater la sainteté effective de bien de ses membres, selon le constat que fait un converti de l’islam que cite l’auteur : « Les lectures que j’ai faites m’ont amené à une deuxième conclusion, celle-ci : le christianisme est supérieur à la religion que je pratiquais aux deux points de vue que je peux, je crois, juger avec quelque peu de sûreté : la morale et la sainteté du fondateur. S’il en est ainsi, et si l’on admet l’existence d’un Dieu personnel, doué de toutes les perfections, il semble impossible qu’il ait permis une erreur aussi belle que le catholicisme ; ce serait contraire à sa sagesse, à sa bonté et à sa justice » (Abd-El-Jalil, cité p. 142). Le témoignage des martyrs et de nombreux saints sont comme l’illustration ce cette réalité historique que tous peuvent constater. A noter que le P. de Blignières nous offre aussi une très heureuse mise au point quant à la nécessaire distinction, mais sans séparation, du temporel et du spirituel dans la communauté humaine, ceci afin d’éviter à la fois l’individualisme anarchique et le totalitarisme (cf. p. 153). Enfin le chapitre 7 démontre l’unité de l’Eglise catholique manifestée à travers toutes les époques et ce malgré les oppositions doctrinales et sociétales qu’elle e rencontrées parfois en son propre sein ou à l’extérieur, le tout constituant ce que l’auteur appelle un véritable miracle moral (cf. p. 175). On l’aura compris, le P. de Blignières s’inscrit dans la lignée féconde d’un Blaise Pascal, d’un John-Henri Newman, d’un Vladimir Soloviev ou d’un Charles Journet pour offrir aux chrétiens et à tous les hommes un beau témoignage d’intelligence missionnaire au service de l’essentiel : l’accueil de la Bonne Nouvelle du salut agissant dans l’histoire des hommes.
Père Laurent-Marie Pocquet du Haut-Jussé, SJM