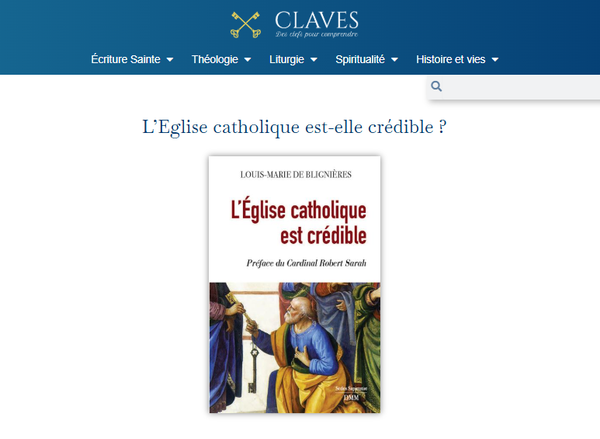LM de Blignières : Comment la paternité est une aventure

Le Père Louis-Marie de Blignières est le fondateur d’une communauté de spiritualité dominicaine à Chémeré-le-Roi, en Mayenne. Figure du mouvement traditionaliste, directeur de la revue de culture générale religieuse Sedes Sapientiae, il est docteur en philosophie pour une thèse sur la pensée métaphysique du Père Guérard des Lauriers. Il nous livre ici quelque chose de son approche ferme et constructive de la société d’aujourd’hui.
Père Louis-Marie de Blignières, apparemment vous ne craignez pas d’être ringard, vous avez eu le courage de publier un livre sur le courage de la paternité. Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ?
Ce livre est fait de chapitres reprenant des textes rédigés pour diverses circonstances, mais je dois dire que j’ai voulu avant tout, à travers cette publication, marquer l’anniversaire de Mai 68, ce mouvement qui a marqué ma jeunesse. J’avais 19 ans en 1968. J’ai 70 ans aujourd’hui. On est passé de « la fête du désir affolé » à la « société dépressive », mais au fond, les mots d’ordre n’ont pas changé. Un demi-siècle nous en sépare, mais les grandes impulsions de Mai 68 sont toujours d’actualité. Il faut dire que la société entrevue dans l’utopie soixante-huitarde est une société dans laquelle le père – je veux dire l’institution paternelle - est devenu l’ennemi à abattre. On a tenté de nous faire oublier le respect dû au père comme symbole de la transmission de la culture. Bref, dans le combat civilisationnel auquel nous sommes contraints aujourd’hui, la défense de la paternité s’impose comme un mot d’ordre absolument central. L’histoire de la philosophie politique est là pour nous rappeler que la société est d’abord un groupe de familles et que le premier pouvoir est, dans ces familles, le pouvoir des pères, qui sont ainsi à la base de la vie sociale.
Comment voyez-vous le rôle du père et de la mère dans la famille ?
On peut dire que, pour le tout-petit déjà, le père est celui qui marque la différence. Un tout petit enfant a un rapport fusionnel avec sa mère, il se distingue mal du corps de sa mère ; il a besoin de cette sécurité fusionnelle. Le père, lui, fait progressivement prendre conscience de l’autre. Il est, pour l’enfant, le premier autre. Il rappelle la loi, il apprend à l’enfant qu’il est dans une certaine nature, qu’il n’a pas fabriquée, qu’il a reçue, toujours dans le cadre d’une culture. J’aime beaucoup cette formule de Simone Weil : « Le réel est rugueux ». Le père, parfois par sa seule présence, est celui qui apprend à l’enfant que le réel est rugueux, alors que la mère continue de marquer la fusion originelle. A l’origine du petit d’homme, il y a deux amours, un amour plus sécurisant, celui de la mère, et un amour fondateur, qui ouvre à la vie sociale. Dans nos maisons religieuses, on voit bien aujourd’hui que les enfants sans père – qui se multiplient – ont du mal à mener à terme leur vocation, parce qu’ils ont souffert de l’absence du père, symbole de l’ordre extérieur à soi, dans lequel l’enfant doit apprendre à grandir.
Est-ce pour cela que Dieu est appelé Père ?
Vous remarquerez que l’Ecriture n’appelle jamais Dieu « Mère ». Il compare Dieu à une mère (dans Isaïe par exemple : « Si une mère pouvait oublier son enfant, moi je ne t’oublierai pas ») mais il ne l’identifie pas au féminin. C’est tout le mystère de l’analogie. Aujourd’hui on est plus sensible à un domaine plus émotif et fusionnel, où se trouve le rôle de la mère. Mais si la Bible a appelé Dieu Père, c’est que, dans l’ordre humain, où l’analogie trouve sa forme première, le père reste, comme je vous le disais à l’instant, le premier témoin de la transcendance. Dieu est Père parce qu’il donne l’être et qu’il donne la loi. Il ne faut pas entendre la loi comme une série d’oukases gratuits. La loi, celle que Dieu donne, la loi naturelle ou la loi du décalogue, c’est la même : elle est l’expression embryonnaire d’une trajectoire, elle est le code de mon développement. A l’inverse du ludisme de Mai 68, la fête sans père, on peut dire que, à travers la loi naturelle ou le décalogue, l’« homme cherche sa propre densité », comme dit Saint-Exupéry.
Des études scientifiques ont démontré semble-t-il qu’aujourd’hui, dans la vie facile de nos société occidentales, l’homme a perdu 20 % de sa densité osseuse. Comme si les corps – le squelette - exprimaient quelque chose de la fragilité des esprits. Que pensez-vous de la fragilité de l’homme contemporain ?
Il faut que les femmes nous aident à être des hommes. Sans une vraie différenciation, il n’y a pas de virilité qui tienne. On dit que les femmes ont besoin de la tendresse des hommes. Et c’est vrai. On n’ose plus dire que les hommes ont besoin, pour être des hommes, d’un regard d’admiration des femmes, des mères ou des épouses. Le chevalier a besoin, pour aller mourir, que sa belle lui jette son mouchoir. Exalter l’homme, ce n’est pas diminuer la femme, au contraire, je le montre dans un chapitre du livre, consacré au « mystère de la femme ». La femme réalise une des façons de monter vers Dieu, comme l’explique Gertrud von Lefort dans La femme éternelle. Elle est, au plan naturel, plus sacrée que l’homme, parce qu’elle porte en elle le mystère de la transmission de la vie. C’est ce que Jean-Paul II a voulu dire quand il appelle les femmes « les sentinelles de l’invisible ». L’expression vaut aussi pour les grands-mères, qui, dans l’éducation de leurs petits-enfants ont un rôle irremplaçable, un rôle apaisé, par rapport aux parents qui s’inquiètent.
Que pense le prêtre dominicain que vous êtes du rôle de saint Joseph auprès du Christ ?
Saint Joseph est fascinant. Bossuet écrit que « son âme a été faite paternelle au Verbe incarné ». Il y a une relation spécifique entre Jésus et Joseph, son père selon la Loi. C’est lui, Joseph, qui reconnaît Jésus, qui lui donne son nom et sa généalogie. Jésus est fils de David, parce qu’il est fils de Joseph. C’est l’homme qui reconnaît l’enfant et lui donne son identité sociale, il ne faut pas lui enlever cela. A Rome, on n’y allait pas par quatre chemins. L’enfant était exposé à la mort s’il n’était pas pris sur les genoux de son père. L’homme est un être de symboles, beaucoup plus que la femme. Il faut qu’il soit honoré, sinon il s’effondre.
Est-ce dans cette perspective que vous consacrez un chapitre bibliographique à la virilité ?
Dans cette bibliographie, je rapproche ce grand soldat français qu’est Hélie Denoix de Saint-Marc, qui a toujours agi conformément à l’honneur, et ce prêtre dominicain d’origine juive un peu oublié aujourd’hui qu’est le Père Jean de Menasce, disant : « J’ai tendance à penser que ce qui manque le plus aux catholiques, c’est le courage ». Ce n’est pas décourageant de dire qu’il faut être courageux. A 16 ans, quand j’ai rejeté la foi, j’ai été marqué par le manque de virilité que dégageait un certain enseignement religieux. Aujourd’hui, si certains sont tentés par l’islam, c’est parce qu’il affirme une force, bien sûr une force dont on doit dire qu’elle est exorbitée, déplacée, mais une force que l’on cherche en vain dans le christianisme actuel. Je pense que pour la retrouver, il faut réaffirmer que la religion catholique, avant tout, est crédible, que le sentiment n’est pas premier dans la foi, et qu’ainsi l’adhésion à la foi est quelque chose de viril. J’avais été frappé dans ma jeunesse par ce titre de Jean-Louis Lagor (Jean Madiran) : « Une autre chevalerie naîtra ». Je pense qu’il a raison : une autre chevalerie naîtra. Elle est en train de naître par exemple, autour de l’organisation SOS Chrétiens d’Orient, tous ces jeunes qui quittent leur confort pour aller aider leurs frères chrétiens à rester en Orient. Je pense à une autre expression, qui me paraît belle : ce qu’il nous faut aujourd’hui, c’est « une insurrection des hommes libres ».
Vous avez une conception très large de la virilité. Je pense à Thérèse d’Avila disant : « Soyez viriles, mes filles (seais hombres, hijas) ! ». La virilité pour vous, c’est aussi aujourd’hui le courage de l’insurrection ?
Pas seulement, mais effectivement, je crois qu’il y a un ras-le-bol de la technocratie et des automatismes qu’elle génère. Deux qualités nous préservent de ne jamais devenir les technos que la société voudrait que nous soyons : il faut d’abord avoir la force, et ensuite il faut l’humour. Prendre les choses avec humour, c’est établir un espace de gratuité, où il ne reste que le rire. Il faut du gratuit pour que la vie soit supportable, il faut faire du gratuit, se mettre à la bonne distance avec le rire. Cette gratuité renvoie aussi à la beauté. L’Eglise aujourd’hui a trop déserté le domaine de la culture et du patrimoine, domaine où elle a toujours eu un rôle majeur. C’est le sens de l’exposition sur saint Vincent Ferrier que nous organisons au Couvent et dont vous avez parlé dans un précédent numéro de Monde et vie. Ceux qui visitent cette exposition qui fait revivre le saint patron de notre Fraternité dominicaine viennent de tous les horizons et ils sont passionnés. Il y a un apostolat de la beauté, qui va bien au-delà du sentiment, si religieux soit-il.
Quelle différence faites-vous spirituellement entre la maternité et la paternité ?
Spirituellement, la maternité donne immédiatement un sens ; la paternité assigne à celui qui en reçoit la dignité une aventure. Il faut bien sûr entendre cette caractérisation de manière analogique. Le sens et l’aventure ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. C’est la modernité qui rend univoque, rationnel et systématique, ce qui, dans la psychologie de l’être humain sexué, est toujours analogue et à prendre avec souplesse.
Propos recueillis par l’abbé G. de Tanoüarn
Interview paru dans Monde et Vie n°976
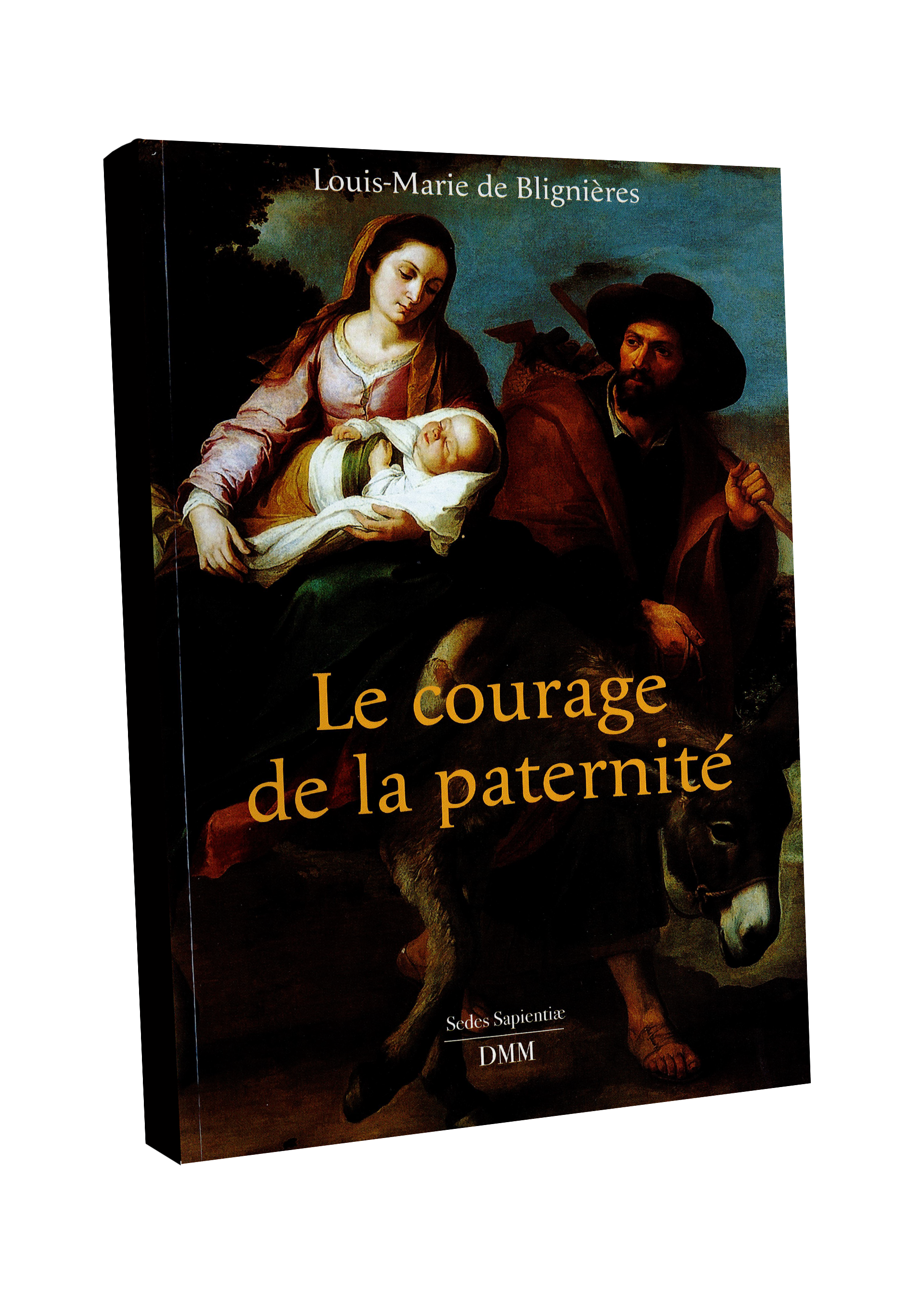
Le courage de la Paternité - par Louis-Marie de Blignières 19,50 € Quantité: Acheter document.querySelector('.product-block .product-block').classList.add('is-first-product-block');